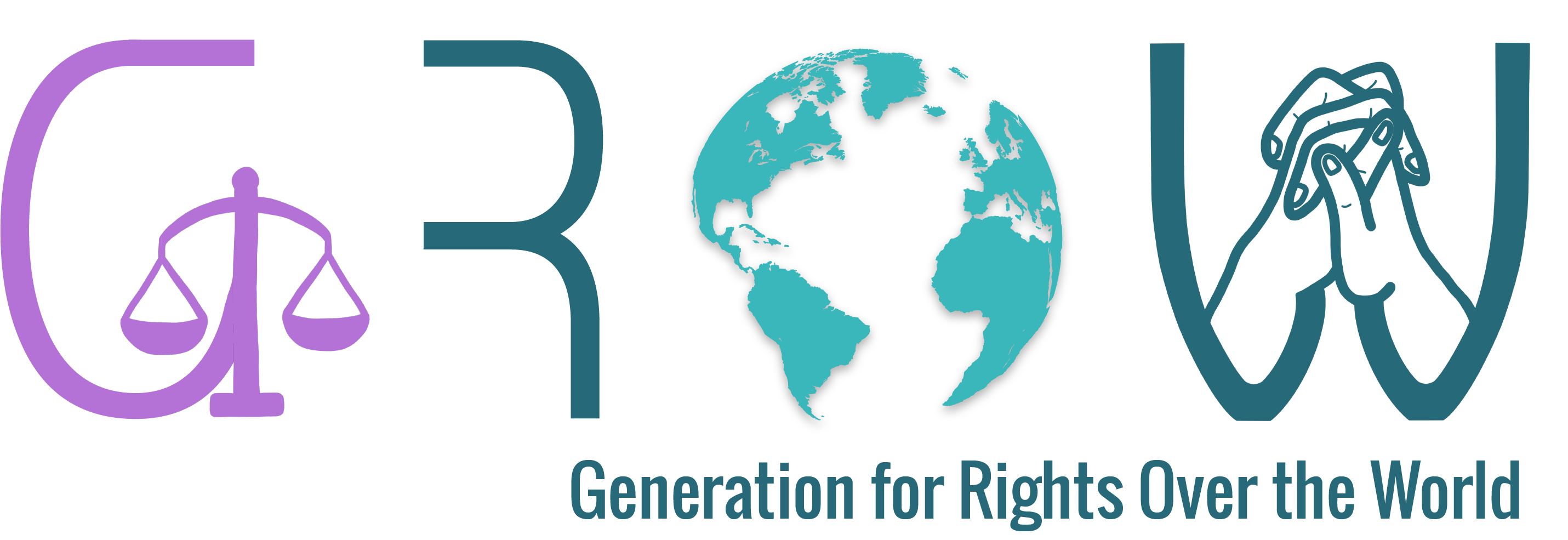Politique extérieure de l’Union européenne et réification des étranger.ère.s : comment réinsérer une rhétorique humaniste comme socle de la politique migratoire européenne ?
Cet entretien a été mené avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022.
Introduction
Suite à une succession d’évènements ayant démontré que la gestion des mouvements migratoires par l’Union européenne est un désastre humanitaire, qu’elle fait fi du respect des droits humains et de ses valeurs fondatrices, que sont la dignité et la solidarité, nous rappelons que la redéfinition de la politique migratoire de l’Union européenne est aujourd’hui un enjeu capital. Cette dernière rencontre un certain nombre de dysfonctionnements et obstacles. On observe notamment une instrumentalisation diplomatique des migrant.e.s par des pays tiers comme le Maroc, le Bélarus ou la Turquie. L’enfermement de migrant.e.s dans des camps, comme à Lesbos, sur l’île de Samos, dans des conditions insalubres, est monnaie courante. Les abandons de migrant.e.s, comme on a pu le voir ces derniers mois avec les événements tragiques survenus dans la Manche et l’abandon des 27 migrant.e.s sur leur embarcation par la France et le Royaume-Uni, se multiplient. Enfin, on remarque l’incapacité flagrante de l’Union européenne à gérer ses frontières, en témoigne la tentative de 1500 migrant.e.s de franchir la clôture de Melilla, séparant l’Espagne et le Maroc, où au moins 23 migrant.e.s y ont trouvé la mort le 24 juin dernier. Se posent alors des questions de coopération entre les pays membres de l’Union européenne et les pays tiers. En outre, la multiplication des pratiques de sécurisation et d’externalisation des frontières met gravement en danger les réfugié.e.s et leurs droits. Comme le rappelle le Haut Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme, ce genre de pratiques constitue une atteinte au principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève de 1951. Il est temps de réinsérer une rhétorique humaniste dans cette politique européenne migratoire.
Dans cette perspective, nous avons réalisé cette interview avec Shoshana Fine. Chercheuse postdoctorale en relations internationales au CERI-Sciences Po, à l’Observatoire Hugo – Université de Liège et à l’Institut allemand d’études mondiales et régionales, Shoshana Fine est aussi membre associée du European Council on Foreign Relations. Titulaire d’un doctorat en sciences politiques et relations internationales, d’une maîtrise en affaires européennes et d’une licence en sociologie, ses recherches portent sur les migrations et les frontières, sur l’Europe, les organisations internationales et la relation entre la connaissance et les interventions de gouvernance. Nous lui avons tout d’abord laissé du temps pour s’exprimer librement sur le sujet de l’interview avant de lui poser notre série de questions.
Je trouve que c’est une approche intéressante. Il est vrai que la migration est une catégorisation qui déshumanise les migrants. Vous avez souligné cette approche sécuritaire des migrants et aussi des réfugiés. On observe aujourd’hui un paradigme dominant concevant les migrants comme un problème ou une menace. Pourquoi ? Est-ce naturel ? Est-ce que cela a toujours été le cas ? Pas vraiment. Aujourd’hui, pourquoi considère-t-on les migrants comme une menace ?
Lorsque l’on s’intéresse aux relations internationales, on peut évoquer le concept de sécurisation, c’est-à-dire la construction de quelque chose en menace, soit par les pratiques, par les politiques, mais aussi par les discours qui associent les migrants à différents types de menaces ou problèmes. Il peut également s’agir de la menace terroriste, comme cela a été le cas dans le contexte du Bataclan, bien que la menace lui préexiste ; ou bien, il peut s’agir d’une menace identitaire, d’une menace culturelle : on voit différents cadrages des migrants comme une menace.
Comment déstabiliser cette construction ? Il faut modifier la façon dont on perçoit les migrants, pas comme une menace sécuritaire, mais comme quelque chose de tout à fait normal. Pourquoi on sécurise la mobilité aujourd’hui ? Pourquoi on considère que la mobilité est dangereuse ? Bien sûr, on ne considère pas réellement la mobilité en soi comme quelque chose de dangereux, mais seulement la mobilité d’une certaine partie de la population. On a d’ailleurs vu dans le contexte COVID cette peur de l’étranger, cette peur de l’extérieur à travers les politiques mises en place pour gérer le COVID, comme le renforcement du contrôle aux frontières, comme si la menace venait de l’extérieur. Ce qu’on a pu voir au Royaume-Uni, c’est très peu de contrôle vis-à-vis de la population britannique, même si c’est en train de changer, et beaucoup de contrôle aux frontières : on a cette vision de l’étranger, de ceux qui viennent de l’extérieur, comme menaçants.
La catégorie de « migrant » n’est pas une catégorie neutre ou une catégorie descriptive. Ce n’est pas juste une catégorie que l’on utilise pour parler de population mobile, pour les personnes qui traversent les frontières. Il y a un imaginaire lié à cette notion de migrants, et on n’applique pas cette notion de migrants à tout le monde. Si l’on regarde du côté de la Commission européenne, quand on parle de la mobilité des citoyens européens dans les différents États membres, on ne parle pas de migrants, mais on parle de mobilité. Quand on pense à la mobilité, on n’a pas le même imaginaire négatif, c’est considéré comme quelque chose de positif. On peut voir la même chose avec l’expat. Bien sûr, sur le plan empirique, on voit la même chose, mais un autre imaginaire y est associé. On peut aussi parler de la question de l’étudiant, en échange, qui n’est pas sécurisée de la même manière que celle des migrants ou bien des réfugiés. La catégorie « migrant » est une catégorie politisée, ce n’est pas seulement une catégorie descriptive, elle possède une dimension de classe très importante et c’est aussi une catégorie très racisée.
Dans quelle mesure la politique migratoire européenne menée depuis une dizaine d’années entre-t-elle en contradiction avec la volonté de l’Union européenne de s’afficher sur la scène internationale comme puissance normative ?
Il y a beaucoup de tension avec cette notion de l’Union européenne comme une force normative, et oui, c’est sûr que l’on voit un certain type de discours assez cosmopolite : respect de valeurs, État de droit, tandis qu’on voit une tout autre pratique vis-à-vis des migrants. C’est également le cas avec les politiques de coopération. On peut d’ailleurs parler, plus de pratique de coopération, de délégation, parce que le concept de coopération renvoie l’image de deux partenaires qui travaillent ensemble, tandis que la délégation permet d’entrevoir les relations de pouvoir.
Il est certain que cela entre en contradiction avec l’Union européenne, qui construit différentes pratiques, différentes frontières, différentes pratiques frontalières pour endiguer ou empêcher les flux migratoires, et on voit très bien, vous avez évoqué l’exemple de Calais, mais on peut voir cela dans différents endroits, la conséquence directe de la politique migratoire européenne : une augmentation des morts de migrants. Souvent, le discours européen reproche ces morts aux passeurs, mais il faut bien sûr prendre en compte le contexte structurel. S’il y avait des voies légales, les passeurs n’auraient pas de business, et migrants et réfugiés pourraient prendre l’avion pour venir en sécurité en Europe pour, par exemple, demander l’asile. Aujourd’hui, il y a un gigantesque fossé entre les discours et les pratiques.
Intéressons-nous à un cas plus concret. Aujourd’hui, l’Union européenne accuse le Bélarus de l’avoir « attaqué à coups de migrant.e.s » en guise de représailles aux sanctions qui ont été prises par l’Union européenne, suite aux violentes répressions des manifestations démocratiques qui avaient suivi la réélection de Loukachenko. De plus en plus, on constate un discours qui s’articule autour des migrant.e.s comme « arme diplomatique ». Est-ce que le flux migratoire est réellement capable de faire imploser l’Europe, ou alors, est-ce plutôt l’imaginaire identitaire européen qui se sent menacé ?
Je pense déjà que c’est assez dangereux, ce discours qui parle des migrants comme d’une arme. En anglais, on parle de « weaponization », et je trouve qu’il faut se méfier de ce type de cadrage qui nourrit cette idée que les migrants seraient une menace. Je pense qu’il faut essayer de trouver un autre vocabulaire pour parler de cette situation. Bien sûr, dans le cas de la Biélorussie, ce ne sont pas les migrants en soi qui sont une menace : on peut parler de 2000, 3000 personnes. Serait-ce réellement une menace pour l’Europe d’ouvrir ses frontières à ces personnes ? Nous avons des ressources pour les accueillir, ça n’est vraiment pas le souci. Ce qu’on voit ici, c’est une sorte de jeu de spectacle des frontières où les différents acteurs européens veulent justement jouer sur cette notion de menace et se positionner comme les hommes forts qui protègent l’Europe des menaces qui viennent à la fois de ces migrants, mais aussi de la Biélorussie. C’est une opportunité pour les Européens d’affirmer leur puissance par la protection de la frontière « pour » la population européenne.
Évidemment, les migrants ne sont pas une menace en soi, dans cet exemple comme dans n’importe quel exemple. Ce ne sont pas les migrants qui sont une menace pour l’Union européenne, mais c’est précisément ce discours sécuritaire qui suscite une angoisse chez les populations. Ce sont les pratiques sécuritaires, qui menacent les migrants, qui suscitent l’angoisse chez les populations, et il y a un lien direct entre les politiques migratoires européennes et l’augmentation de mort de migrants : ce sont des politiques avec des conséquences très graves.
Pensez-vous qu’il est réellement possible que le Bélarus ait orchestré ce flux migratoire ? Est-il concrètement possible de manipuler les flux migratoires à notre guise pour les utiliser comme des « armes », ou bien est-ce une construction liée à une peur européenne ? Quel est le processus derrière cette idée de flux migratoire qu’on manipulerait pour l’amener à la frontière européenne ?
Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. Il est vrai que la Biélorussie a ouvert certaines frontières, mis en place des avions, mais on ne peut pas totalement manipuler les flux de migrants. Bien sûr, parce qu’on a supprimé les visas, des individus venus du Moyen-Orient pouvaient venir en Biélorussie sans visa. C’est pour eux une manière de venir plus près de l’Europe pour éventuellement y rentrer. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui prenaient l’avion avaient l’intention de venir en Europe : il y a un imaginaire, dans l’Union européenne, que tout le monde souhaite venir chez nous, parce que l’on vit bien, etc. Mais on sait très bien que dans la pratique, ce n’est pas le cas. Si on prend le cas d’un sujet Syrien à la suite de la crise des réfugiés syriens en Europe, selon les chiffres, la plupart de réfugiés syriens étaient accueillis dans les pays voisins de la Syrie : la Turquie, le Liban, ou encore la Jordanie.
Bien sûr, certains avaient envie de quitter ces pays-là, peut-être de venir en Europe ou bien d’aller ailleurs, mais il y en avait beaucoup aussi qui avaient envie de rester là-bas pour différentes raisons. Les migrants, comme on l’a dit, sont des êtres humains. Ils pensent, ils réfléchissent, ils ont leur propre capacité d’agir, leurs propres ambitions, objectifs dans la vie. On ne peut pas les mettre tous dans la même case et c’est pour cela qu’il est problématique de parler, par exemple, de migrants de transit, car on ne prend pas en compte la place de l’individualité dans cette notion de flux migratoire. Je pense que l’on devrait aussi se méfier de cette notion de flux : qu’est-ce que ce terme désigne concrètement ?
Toujours pour continuer sur cette question de l’instrumentalisation diplomatique, doit-on voir dans cette pratique de l’instrumentalisation des migrant.e.s une inévitable conséquence du travail d’externalisation de l’Union européenne, de sa propre frontière ?
Il y a toute une littérature sur ce qu’on appelle « migration diplomacy » qui traite de cette question. Oui, on sait très bien que depuis une vingtaine d’années et surtout depuis la soi-disant crise migratoire de 2015, il y a beaucoup d’actions d’externalisation, c’est-à-dire de coopération avec les pays tiers, sur la question migratoire. C’est une politique qui essaie d’endiguer les migrants avant qu’ils arrivent en Europe. Pourquoi font-ils cela ? Parce que justement, l’Union européenne a beaucoup moins d’obligations vis-à-vis de ces personnes si elles ne sont pas sur son territoire. Par exemple, pour faire une demande d’asile, dans 90% des cas, il faut être sur le territoire. On peut faire une demande dans un pays tiers, mais l’Union européenne accueille très peu de ces personnes. C’était une petite divergence, mais je pense que c’est important de comprendre un peu mieux le contexte de l’externalisation.
On constate la construction d’une menace avec ces partenaires. On leur donne un rôle important dans la politique migratoire européenne, ce qui donne une certaine marge de manœuvre à l’Union européenne qui propose, en échange du contrôle des flux migratoires, des aides au développement et/ou des coopérations dans différents domaines bien éloignés du domaine migratoire. Cela devient une question centrale dans la diplomatie, les relations entre l’Union européenne et d’autres pays. C’est quelque chose qui aujourd’hui est extrêmement médiatisé. On prend souvent le cas de la Turquie, ou actuellement de la Biélorussie, mais la migration dans la diplomatie a toujours été présente. On peut observer les accords d’il y a 20 ans qui, justement, imposaient une conditionnalité vis-à-vis de beaucoup d’États africains. Si eux ne jouaient pas le jeu pour empêcher leurs ressortissants ou d’autres personnes provenant d’Afrique de venir en Europe, eux recevaient moins d’aides au développement, voire aucune.
Pour poursuivre sur la façon dont l’Europe met en place des décisions vis-à-vis des politiques migratoires, qu’en est-il du système de prise de décision. Aujourd’hui, le service européen pour l’action extérieure est basé sur le consensus. Doit-il selon vous être réformé, comme cela a déjà été suggéré par plusieurs dirigeant.e.s dont Angela Merkel, peut-être au privilège d’une prise de décision qui serait majoritaire et non plus consensuelle, pour éviter, par exemple, qu’un pays bloque une décision de politique migratoire par pur intérêt personnel ?
Oui, mais je dirais que ce n’est pas juste cela qui changera les choses. Là, on a un problème structurel. Vous avez évoqué l’imaginaire du « migrant-menace » : ce problème ne sera pas changé avec différents types de prises de décision. Il ne faut pas faire une petite modification des politiques, mais il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire, qui permettra de ne pas voir les migrants ou les réfugiés comme une menace, mais comme des personnes qui peuvent aussi contribuer à notre société. Il est vrai qu’il y a eu beaucoup de problèmes ces dernières années avec certains pays qui ne jouaient pas le jeu en termes de coopération, mais on peut se demander : pour quel type de coopération ? Souvent, on parle de la solidarité européenne pour les États membres qui coopèrent ensemble sur les politiques migratoires, mais c’est une coopération pour renforcer les frontières, pour empêcher les migrants et les réfugiés de venir en Europe. On parle très peu de la solidarité vis-à-vis des migrants et des réfugiés.
Comment modifier cet imaginaire ? Parce que s’il s’agit de quelque chose de structurel et que changer simplement la manière dont on prend la décision à l’échelle de l’Union européenne ne suffit pas, comment parvenir à changer, de manière structurelle, un imaginaire collectif ? Est-ce que ce changement ne passe pas plutôt par la sensibilisation à travers les médias du peuple ? Ou par d’autres acteur.trice.s de la frontière, et à quoi ressemble ce changement ?
C’est une question très compliquée et je pense que c’est quelque chose qui n’arrivera pas demain. Comment changer un imaginaire ? Pour commencer, les médias, suivant la façon dont ils présentent les migrants, nourrissent cet imaginaire. Souvent, on présente le migrant comme un problème ou une victime, mais très rarement comme quelqu’un qui peut contribuer positivement à la société. Je pense que les médias ont un rôle très important à jouer et bien sûr, les politiques aussi. On a parlé avant de l’importance de la manière de construire les politiques, et justement les politiques jouent un rôle très important dans la construction de notre imaginaire. Si on avait des politiques qui géraient les migrants d’une manière plus digne, ou ne créaient pas un sentiment de chaos ou de mort à la frontière, cela impacterait notre imaginaire.
On est dans une situation où ces pratiques sécuritaires créent un certain imaginaire de chaos à la frontière. On nous montre par exemple les images d’un bateau qui ne peut pas trouver un port pendant deux semaines, avec 300 migrants à son bord, comme si ce bateau pouvait avoir un impact très menaçant sur le territoire européen : bien sûr ce n’est pas le cas. Si on avait une autre image de ce bateau, ou bien si les personnes sur ce bateau pouvaient en descendre tranquillement, cela nourrirait notre imaginaire différemment. On sait très bien que c’est l’imaginaire qui joue ici. Quand on regarde qui vote pour les partis d’extrême droite, très anti-migratoires, il s’agit souvent d’individus venant de régions où il n’y a pas de migrants. Je pense justement que les médias et ces politiques, pratiques, sécuritaires ont un rôle majeur. Un changement de paradigme est possible.
Après, je pense qu’il faut arrêter d’utiliser cette notion de migrant.e.s. En effet, comme on l’a vu au début, quand on en évoque différents types des catégories comme étudiant en échange, expat, mobilité, on fait appel à un tout autre imaginaire.
Étant donné que nous parlons de discours et d’imaginaire de migration, nous allons parler de la France. L’ex-candidat à l’élection présidentielle Arnaud Montebourg, candidat de gauche, a proposé, avant de se dédire, de geler les transferts de fonds privés vers les pays dont le gouvernement n’accepte pas le retour des ressortissant.e.s dont la demande d’asile a été déboutée. Que cela indique-t-il de la ligne idéologique des gauches européennes selon vous ?
Il n’y a vraiment de véritable parti pro migratoire. Peut-être l’a-t-on un peu plus vu avec les Verts, notamment en Allemagne, il y a quelques années. Mais je pense qu’aujourd’hui ce n’est plus tout à fait le cas. On voit cela même avec les partis d’extrême gauche. Évidemment, la gauche propose différents types de politiques. Il y a un discours, beaucoup moins explicitement raciste par rapport à ce qu’on peut voir à droite ou à l’extrême droite, mais ce qu’on voit dans les partis de gauche, c’est aussi cette idée que la mobilité est quelque chose de mauvais et que l’on est mieux chez nous. L’idée est que ce n’est jamais bien de traverser la frontière. Oui, c’est une bonne chose pour le tourisme, mais on est toujours mieux à la maison. On constate ce phénomène au travers de discours politiques, par exemple avec Mélenchon, qui parlait du fait qu’il faut donner plus d’aide au développement pour que les personnes ne fuient pas de chez elles et puissent rester en Afrique. On voit quand même cette idée, même très à gauche, que la migration est quelque chose de néfaste.
On voit le même discours avec les organisations internationales, qui cadrent la mobilité moins comme une menace qu’un problème, quand bien même elles se positionnent comme apolitiques : techniquement, on voit aussi ce même cadrage de la mobilité comme quelque chose de mauvais.
Tant que vous nous parlez des organisations internationales, est-ce que vous pourriez nous décrire le rôle de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des retours volontaires qu’elle met en place, et comment ça transforme l’imaginaire des migrant.e.s, plutôt que l’imaginaire des Européen.ne.s, par rapport à la déportation, phénomène que vous appelez, je crois, le deportation twist ?
C’est un article qui vient de sortir, il y a deux mois (octobre 2021), que j’ai écrit avec William Walters, un universitaire du Canada. Chez l’OIM, comme dans toutes les organisations internationales, on ne voit pas un discours de droite, un discours raciste, qui construirait les migrants comme une menace, mais la migration est toujours un problème : on est mieux chez nous. OIM signifie Organisation internationale pour les migrants, mais il y en a beaucoup qui l’appellent l’Organisation internationale contre les migrants. Nous nous sommes intéressés à cette pratique de retour volontaire. C’est une pratique très importante aujourd’hui dans l’Union européenne, mais aussi ailleurs, pour inciter les demandeurs d’asile déboutés, les personnes sans papiers, à retourner dans leur soi-disant pays d’origine. Si elles n’acceptent pas ces programmes, l’alternative, c’est la déportation, l’expulsion : il n’y a pas vraiment de choix. Beaucoup d’études montrent que ce n’est pas réellement un retour volontaire, même si les individus ne sont pas mis en cellule avant de partir, il y a quand même une forme d’obligation à revenir dans le pays d’origine. Ce qu’on peut voir avec l’OIM, c’est une sorte de prolongement de l’expulsion, pas exactement similaire à une expulsion classique avec beaucoup de violence explicite, mais on voit un processus qui est assurément très lié et on voit que l’OIM trouve des manières de cadrer ces pratiques comme quelque chose d’humanitaire, qui serait dans l’intérêt des migrants. L’OIM parle beaucoup de réunification familiale : « La migration était mauvaise, vous étiez éloigné de votre famille, nous allons vous aider à revenir chez vos parents ». On constate aussi un autre discours, visant à aider le migrant qui est revenu à construire son entreprise : l’OIM se fait aussi acteur du développement. Il y a donc différents types de discours utilisés pour construire cette pratique d’expulsion comme quelque chose de positif, d’humanitaire et dans l’intérêt des migrants.
Au 1 janvier 2022, la France a pris la présidence de l’Union européenne. Emmanuel Macron a déjà dit qu’il espérait débloquer la situation migratoire en Europe avec une réforme des règles de l’espace Schengen et notamment en appliquant le principe de non-admission, par opposition au principe de non-refoulement. En 2015, il y avait déjà eu une expérimentation qui avait été faite dans les Alpes maritimes, qui consistait à la mise en place d’une zone de 20 km depuis la frontière Franco-italienne à l’intérieur du territoire français, au sein de laquelle les migrant.e.s qui seraient interpellé.e.s seraient directement expulsé.e.s en Italie, comme s’iels n’avaient jamais pénétré le territoire français. Pensez-vous que la volonté d’appliquer le principe de non-admission systématiquement à tous les territoires de l’Union européenne soit symptomatique de la direction que prendront les développements futurs de la politique migratoire européenne ?
Oui, c’est symptomatique de quelque chose de plus large. Ça s’inscrit justement dans cette politique d’externalisation, qui essaie de déléguer toujours plus loin. On peut voir ça aussi au sein de l’Union européenne : il y a beaucoup de conflits parmi les différents États-membres parce que justement, aujourd’hui, il y a ce qu’on appelle la régulation de Dublin. Quand une demande d’asile arrive en Europe, elle a d’abord été faite dans le premier pays où l’on a mis un pied, ce qui n’est évidemment ni la France ni l’Allemagne. C’est plutôt la Grèce, l’Italie, les pays frontaliers. Donc cette idée de créer une zone de non-droit frontalier pour ne pas avoir à assumer nos responsabilités, oui, est symptomatique de ce qu’on voit dans l’Union européenne aujourd’hui. Pour donner un exemple, pour faire une demande d’asile en Europe aujourd’hui, il faut tromper la loi, parce que c’est presque impossible de venir dans l’Union européenne sans faire appel à un passeur ou prendre une voie illégale. L’Union européenne et les acteurs politiques de l’Union européenne justifient cela en disant qu’on amène les vrais réfugiés, honorables et méritants, dans l’Union européenne, mais on sait très bien que cela concerne très peu de personnes, même pas quelques milliers de réfugiés par an. Si on considère les chiffres du nombre de réfugiés qui sont accueillis dans des pays comme la Turquie ou la Libye, où beaucoup de réfugiés ne sont pas nommés comme tels car ce ne sont pas des pays signataires de la Convention de Genève, les chiffres en Europe sont minimes. Cette politique, absolument liée à l’exemple que vous avez donné tout à l’heure, vise à déléguer ces responsabilités en l’attribuant à un autre acteur. On voit cela dans le cadre de Dublin, avec l’Allemagne qui déclare « ce n’est pas de notre responsabilité, mais de celle de l’Italie », également avec l’Italie qui répliquera « ce n’est pas de ma responsabilité, c’est de celle de la Libye » et ainsi de suite. On constate la même chose avec l’exemple que vous avez évoqué en France.
L’article 7 du traité de l’Union européenne permet de sanctionner un État membre pour des violations des lois constitutionnelles de l’Union européenne dont le principe de non-refoulement fait justement partie. En revanche, dans d’autres contextes, comme le cas de l’effacement de l’État de droit en Pologne, il est difficile d’activer cet article 7 du fait des mécanismes de prise de décision au sein de l’Union européenne. Il s’avère en définitive que ces mécanismes de sanctions ne semblent pas mobilisables. Quelles seraient les directives que vous donneriez aux dirigeant.e.s politiques de l’Union européenne afin de faire appliquer les droits humains des migrant.e.s, prenant par exemple la situation à la frontière entre la Pologne et le Bélarus ?
Alors, pour parler plus largement, il n’y a pas aujourd’hui de pratiques de sauvetage européen, cette pratique n’existe pas. Nous avons la surveillance de Frontex, mais pas de pratique active de sauvetage : ce serait une première chose à mettre en place, parce que, comme je l’ai dit, il y a une augmentation des migrants qui meurent en venant en Europe et ça, c’est un problème. Il faut aussi ouvrir les voies légales pour les migrants, mais également pour les réfugiés. On peut par exemple donner des visas humanitaires pour ces personnes, de manière à ce qu’elles ne soient pas obligées de prendre un bateau délabré, mais plutôt qu’elles puissent prendre un billet d’avion avec leur famille. Ce serait une deuxième solution à court terme. Troisièmement, je parlais de réinstallation. Il faut mettre l’accent sur cette politique. On parle de chiffres très bas, mais il n’empêche que l’on peut aussi imaginer quelque chose pour ça. Je pense qu’il faut imaginer quelque chose pour mettre fin aux morts de migrants, pour que le migrant n’ait pas à faire face à la mort pour venir en Europe. On voit les réfugiés fuyant la persécution faire face à d’autres problèmes en tentant de résoudre leur situation. On a également beaucoup parlé de la coopération avec différents pays, les pays tiers, et j’ai souligné cette sorte de délégation. On peut imaginer une coopération qui ne serait pas une coopération sécuritaire, visant à empêcher les migrants de venir en Europe, mais une coopération justement pour laisser les individus passer dignement. De même, avec la coopération européenne, on peut imaginer une coopération pas seulement pour déléguer les responsabilités, mais aussi accueillante vis-à-vis des migrants.
Ce que vous soulignez dans votre réponse, c’est qu’il est nécessaire de déconstruire les concepts de « migrant.e », de « frontières » et de « limitation » et plutôt se poser la question des droits des migrant.e.s. Finalement, ce dont vous parlez, c’est potentiellement d’un droit à la mobilité. Pourriez-vous élaborer sur la question ? À quoi ressemblerait exactement un tel droit ?
Un droit à la mobilité, c’est très simple : aujourd’hui, une grande partie de la population n’a pas le droit de traverser la frontière, par exemple pour rentrer en Europe. On peut considérer la mobilité comme un droit fondamental, un peu comme le fait que tout le monde devrait avoir suffisamment à manger, ou que tout le monde devrait avoir l’accès à l’éducation. On peut imaginer que tout le monde puisse avoir un droit à la mobilité. Pourquoi cela serait-il réservé à une petite partie de la population ? Cela évoque les pratiques féodales, au travers desquelles un individu avait certains bénéfices parce qu’il était né dans un certain lieu tandis qu’un autre en avait moins. Aujourd’hui, on n’a pas de droit à la mobilité, mais quand on y pense, cet état de fait ne semble pas très cohérent et ce n’est certainement pas très juste.
Aujourd’hui, les conséquences du dérèglement climatique sont un réel sujet qui inquiète les dirigeant.e.s européen.ne.s, d’autant plus du fait de l’intensification des flux migratoires et de ses conséquences. Une question se pose, celle des réfugié.e.s climatiques. Pensez-vous qu’il serait pertinent de créer un statut spécifique de réfugié.e.s climatiques dans le cadre de la Convention de Genève de 1951 ?
Bien sûr, je pense que ça serait très pertinent. Justement, il y a de plus en plus de personnes qui doivent fuir leur maison à cause de changements climatiques. Je pense que l’on est très loin de cela. On voit très bien aujourd’hui que les types de persécutions qui sont valorisés par la Convention de Genève sont très restreints. Je donne souvent l’exemple de quelqu’un qui fuit la faim, qui n’est pas considéré comme un réfugié selon la Convention de Genève, puisque pour la Convention, la pauvreté n’est pas une raison légitime de fuir. La Convention de Genève se focalise davantage sur la persécution individuelle. Je pense donc que le changement climatique est aussi un très grand sujet à intégrer à la Convention de Genève, mais je pense que l’on en est assez loin. Bien sûr, c’est extrêmement important et cela le sera de plus en plus dans les années à venir.
François Gemenne1 argue que créer ce statut spécifique dans la Convention de Genève n’aurait pas réellement de sens puisque migration climatique et migration politico-économique se recoupent. Selon lui, il est difficile de savoir quelle est l’origine réelle de la migration. Plutôt que d’ajouter un statut supplémentaire à la Convention de Genève, est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt réformer cette convention, étant donné qu’elle se base finalement sur des perceptions des migrations qui datent des années 1950 et que les réalités ont totalement changé aujourd’hui ?
Ce n’est pas seulement une question de réalités changées. La Convention de Genève a été créée dans le contexte de la Guerre froide. Ce n’était pas simplement une politique de bienveillance humanitaire de la part de certains pays, elle avait une dimension stratégique qui était d’exercer un certain pouvoir sur l’Union soviétique, et c’est pour cela que l’accent est mis sur la question de persécution individuelle. À l’époque, il y avait des individus qui auraient dû mériter une protection et pour qui cela n’a pas été le cas, et ce n’est pas non plus le cas aujourd’hui. Ce système, la Convention, c’est une politique qui est très limitée. Il faut louer son existence et la possibilité d’obtenir le statut de réfugié, néanmoins son caractère sélectif est quelque chose de réellement problématique. On protège uniquement certains individus et c’est éminemment politique. Aujourd’hui, par exemple, on observe au sein des pays, notamment européens, une multiplication des pratiques de pays « sûrs ». Les personnes qui proviennent de pays jugés « sûrs » ont moins de facilité d’accès à l’asile, puisque par définition elles ne sont pas considérées comme en danger dans leur pays d’origine. On a parlé aujourd’hui de différentes pratiques (réglement Dublin III, pratiques d’externalisation) qui rendent difficile l’accès à la demande d’asile, comme leur régulation, mais bien sûr on voit aussi une dimension frontalière au sein de la Convention de Genève qui protège seulement d’un certain type de persécution et non pas d’autres.
Pour nous concentrer sur votre propre recherche, vous êtes spécialiste singulièrement de la Turquie, vous y êtes rendue à plusieurs reprises, et vous avez beaucoup écrit sur le sujet. Est-ce qu’aujourd’hui vous avez l’intention de continuer à travailler spécifiquement sur la Turquie ? Sur quoi allez-vous écrire et sur quoi avez-vous envie d’écrire ?
Je travaille effectivement sur la Turquie en ce moment, sur un article. Aussi, en termes de recherche, je m’intéresse avec une collègue à la question de la loi dans la justification de la violence vis-à-vis les migrants. On a parlé un petit peu aujourd’hui de la façon pour les pays de déléguer à d’autres pays en disant « on aimerait bien aider, mais ce n’est pas de notre responsabilité ». On voit beaucoup de violence en conséquence de ce type de politique. Par exemple, on a dit qu’il n’y avait plus de pratique de sauvetage en mer aujourd’hui et les défenseurs de l’Union européenne disent que c’était plutôt la responsabilité de Libye. Ainsi, on voit les différentes manières dont la loi est évoquée pour justifier certaines politiques vis-à-vis des migrants et c’est le policier qui souvent, mène à la mort de ces personnes. Je m’intéresse donc à comment on utilise la loi pour justifier ce type de politique. Quand on fait appel à la loi, on pense que la loi est neutre, morale, une force du bien, mais en réalité, on essaie de déconstruire tout cela et montrer que la loi n’est pas toujours morale, n’est pas toujours quelque chose de positif et que c’est quelque chose de très politique justement, qui conduit à beaucoup de violence.
Auriez-vous des recommandations accessibles à tou.te.s à nous conseiller, afin d’approfondir le sujet ?

Humanitarian Borders de Polly Pallister-Wilkins, aux Éditions Verso. Je pense que c’est un livre pour tout le monde, assez accessible, mais aussi une très bonne critique des politiques migratoires.
Lien vers la librairie en ligne permettant de se procurer l’œuvre : https://www.versobooks.com/books/4013-humanitarian-borders
| ↑1 | François Gemenne est professeur de géopolitique de l’environnement à Sciences Po Paris ainsi qu’à l’Université libre de Bruxelles. Il est spécialiste des questions migratoires, des déplacements de population liés aux changements de l’environnement et aux politiques d’adaptation au dérèglement climatique. |
|---|